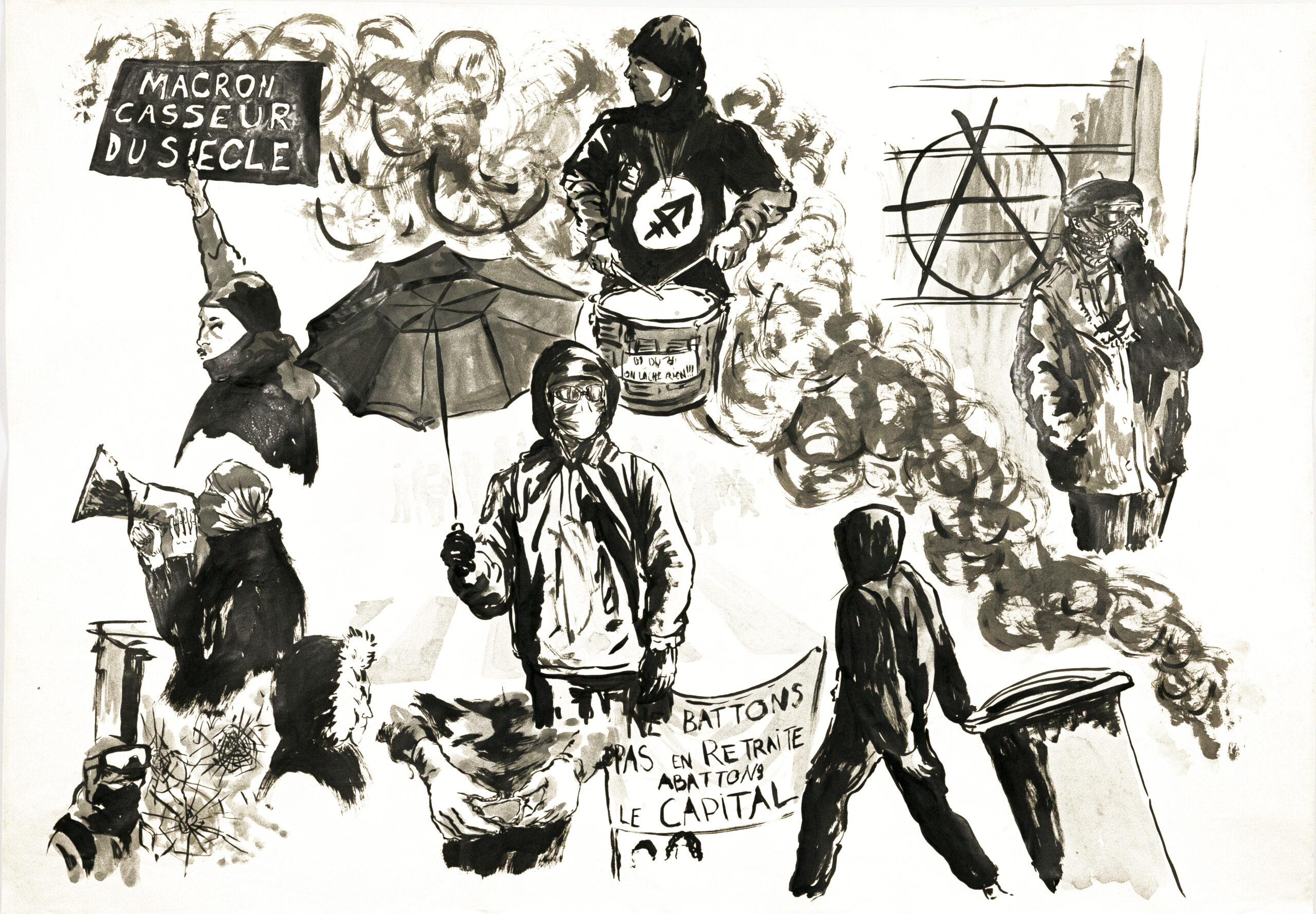Le mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2024, Gilles Clément, jardinier, paysagiste, artiste et auteur, a été invité à Brest pour trois temps d’échange.
1 /Conférence à la fac des lettres de Brest
Durant ce premier temps, Gilles Clément a présenté son approche du vivant et des jardins tout en agrémentant son récit de diverses images projetées et d’anecdotes (vécues, racontées, glanées pendant ses voyages, imaginées ? on ne sait pas toujours). Se définissant comme jardinier plutôt que paysagiste, l’artiste a retracé ses projets qu’il a classé en plusieurs parties. Pour ces idées, il a créé des espaces mis à la disposition du public qui choisit la forme et le mouvement donné au lieu. Toujours en soustrayant et jamais en ajoutant, l’idée est de faire “avec” et pas “contre”.
L’artiste est d’abord revenu sur le terme de Nature. Inventé en Grèce antique, ce mot permettait de mettre le vivant hors de l’humain et l’étudier, menant à une trop grande distance et différenciation. Ensuite, il a abordé le “Jardin en mouvement” : celui où on observe d’abord le vivant et sa manière singulière de pousser sur un terrain avant de le structurer. C’est le voyage des graines, illustré par l’histoire d’une Berce du Caucase dans son jardin qui a poussé sur un chemin amenant le déplacement de ce dernier. Le jardin change et bouge, les plantes évoluent d’elles-mêmes modifiant ainsi le paysage. Il y a aussi le jardinage par soustraction, en enlevant les plantes pour garder celles voulues au lieu d’en rajouter, le dessin de la jardinier.re avec sa tondeuse…
Il a aussi mentionné le “jardin planétaire” : celui où l’on considère la planète entière comme un jardin. Selon lui, grâce aux nouvelles technologies, on peut avoir une vision de ce qui se passe là où on n’est pas, à d’autres latitudes et longitudes. Comme une couverture anthropique, l’homme/jardinier est partout sur la/le Terre/jardin. Il a également parlé de brassage planétaire, les plantes qui traversent (ou pas) les océans comme les coco-fesses qui coulent et les graines de coco qui flottent, comme nous. Il a évoqué la question des enclos, le vivant enclos dans la biosphère, les frontières que les humains construisent…Et un dessin de chute de vaches sur un tee-shirt.
“Ce sont les oiseaux, le vent… qui ont fait l’île.”
Enfin le jardinier-artiste a abordé le “Tiers Paysage”, là où le vivant se développe dans des zones délaissées comme des friches, des bords de route… (là où les rudéral.e.s poussent ;)) Il nous a montré l’île d’Herborence (en photo). C’est une parcelle de terre inaccessible au public entourée de mur où la flore et la faune se développent librement. : “Ce sont les oiseaux, le vent… qui ont fait l’île”. Il nous a aussi montré des dessins de jardins qu’il a imaginé dans Notre-Dame de Paris. Quelqu’un dans la salle le questionne sur le mode productif du jardinage. “Ne pouvons-nous pas seulement nous contenter d’un temps de contemplation ?”. Il répond : “Quand vous êtes au jardin vous perdez la notion du temps et tant mieux”.
Dans le cadre de cette invitation tournée vers le cycle de recherche de l’UBO “Urgence et émotions”, il a évoqué l’idée de changer. Changer notre vision de “ce qu’il faut faire” : la monoculture, nos modes de vie producteurs et consommateurs et instaurer la désobéissance contre la pression du rendement imposé par la PAC/prêt. D’après lui, “la performance tue” et prendre son temps avec le vivant est primordial. Pour cette idée, il a plusieurs fois cité le livre Antidote au culte de la performance de Olivier Hamant.
La conférence a été assez riche en informations, distribuées avec la parole en arborescence de Gilles Clément, toutes ne peuvent être reportées dans ce compte rendu mais voici d’autres informations flottantes: un hectare de gazon de plastique du lycée français de Madrid, des anémomorphoses d’arbres tordus par le vent et le polymorphisme du lierre, les enveloppements d’un arbre à Mouans Sartoux, les graines naissant des incendies, les “frontières de timidité” des arbres, le Collectif Le temps de la Terre qui travaille sans moteur, un olivier en Grèce qui traverse un mur, la grève des chiens errants à Santiago, une tour à eau et un dindon américain qui est venu à l’île Maurice pour remplacer un dodo et faire germer des graines.
Les axes de réflexions de cette conférence reprennent des notions qu’il aborde dans ses livres (si vous voulez creuser plus en profondeur) : Le jardin en mouvement, La jardin planétaire, Manifeste du Tiers-paysage, Eloge de la friche, Notre-Dame-des-Plantes…
2/ Création d’un jardin tinctorial aux beaux-arts de Brest
Les étudiant.es et professeur.es de Brest ont présenté leur projet de jardin à Gilles Clément et iels lui ont fait visiter la parcelle de terre située entre l’école, le conservatoire et le musée des Beaux-Arts.
Dans la salle de volume de l’école, divers supports de recherches ont été disposés : des plans de jardins, des dessins, une maquette, des plantes étendues, des essais de peintures aux encres végétales (sumac, galle de chêne et ronce) réalisées par la professeure de gravure Marie-Claire Graillot et les étudiant.es. Sur une table de recherche est posé un livre : Le monde des teintures naturelles de Dominique Cardon, conseillé par Gilles Clément pendant la conférence (les grands esprits se rencontrent).
La volonté de créer ce jardin se divise en trois axes. Un axe autour des plantes tinctoriales. Un autre autour des fibres végétales et de leur utilisation textile, en lien avec l’option Design d’espace proposée à Brest. Et le dernier se concentrant sur l’éco-pâturage, le lien à l’animal ou l’utilisation de matières animales, comme la laine pour pailler. Seulement pour l’instant il y a peu d’espoir que des animaux puissent s’y installer. Le jardin a été inauguré en début d’année scolaire. Les étudiant.es ont eu un workshop d’une semaine durant laquelle iels se sont retrouvé.es autour du jardin pour le nettoyer (il y avait beaucoup de déchets car il n’était pas considéré comme un jardin), désherber, et construire des bacs en bois avec un système de lasagne à l’intérieur : une couche de carton, une couche de fumier, une couche d’herbe ou de copeaux de bois récupérés en atelier bois. Pour connaître la nature du sol, sa composition et sa profondeur, iels ont aussi fait des carottages (profondeur, PH).
Maintenant, c’est chaque mardi que les étudiant.es, toutes années confondues, se réunissent pour réfléchir à l’organisation du jardin. La parcelle de Brest est plus grande qu’à Lorient (900m²) et l’accès est ouvert au public. L’envie d’en faire un lieu social est aussi un point de réflexion. Le fait qu’il soit accessible au public permet de penser un relai de personnes qui s’occupent du jardin quand l’école est fermée, notamment pour les grandes vacances d’été en sollicitant peut-être le voisinage dans le projet. Cela impliquerait que cet espace devienne un lieu de passage et qu’il y ait une sensibilisation à faire en créant des panneaux d’informations botaniques, par exemple pour la protection des orties, ou encore en créant un urinoir autour de ces derniers, car ils sont friands d’azotes. De plus, il aurait l’objectif d’y construire un dôme géodésique. Dans cette optique d’améliorer l’espace urbain, le projet a reçu une subvention de 900 euros de la mairie.
Les étudiant.es et professeur.res ont pu poser des questions à Gilles Clément autour de ce jardin. Faut-il construire des chemins ? Comment circuler dans celui-ci ? Comment garder une part de “jardin en mouvement” avec les bacs ? Les réponses semblaient vouloir plutôt laisser “se faire les usages spontanés”, ne pas prédéterminer et pré-penser le vivant pour plutôt laisser les chemins se former tout seul et potentiellement venir les dessiner seulement après. Une belle discussion a aussi eu lieu autour de l’ortie, qui offre des fibres utilisables pour le textile. Comme dit plus haut, celle-ci aime l’azote et d’après le jardinier-paysagiste sa meilleure nourriture serait l’urine, d’Homme ou d’animal. Seulement, les particules des médicaments que l’on ingère s’y trouvent et sont mauvaises pour les plantes. Ainsi, il faudrait que seules les personnes non médicamentées les arrosent d’urine, ce qui peut sembler moins pratique. D’ailleurs, tant mieux que des orties soient plantées ici, les plantains qui courent partout dans l’herbe aideront à apaiser leurs piqûres.
3/ Echange avec les étudiant.es de la fac d’arts plastiques de Brest
Le Conservatoire botanique national de Brest nous a accueilli dans une de ses salles pour nous réunir autour d’une présentation des projets artistiques des étudiant.es de l’UBO.
Comme entrée en matière, un.e étudiant.e évoque l’Écologie des relations de Philippe Descola en définissant quatre concepts clés pour les différentes perceptions des relations Homme/animal. Le Naturalisme décrit l’Homme comme ayant une intériorité, tandis que les autres êtres vivants ne l’ont pas. Seulement, ils sont communément soumis aux mêmes lois physiques (gravité, chimie…). L’Animisme dit que tous les êtres ont une intériorité mais qui est différente pour chaque être car ce sont différents corps. D’après le Totémisme, tous ont une physicalité et une intériorité, mais propre à un groupe précis, ainsi les êtres vivants seraient répartis dans plusieurs groupes. Finalement, l’Analogisme prône que tous sont singuliers tant dans leur physicalité que leur intériorité. Ces réflexions sont rassemblées en 4 petites plaquettes/éditions graphiques.
“Choisir entre bêche et crayon”
Les productions de chacun.es ont été très variées (feuilles végétales poinçonnées, tissage, empreintes, aquarelles, gravures, interventions dans le paysage…). En réponse, Gilles Clément a évoqué diverses réflexions et anecdotes. Comme la hiérarchie sociale des plantes, “le cheminement par l’incitation” où l’on se promène sans chemin existant. La Ferme du bonheur qui a voulu remplacer sa terre polluée, alors que les plantes présentes travaillaient déjà vers la dépollution du lieu. Ou encore la naissance de son livre Les imprévisibles, l’ouvrage qui rassemble les petits dessins de bout de papier lors des appels téléphoniques et les mouvements automatiques. “Choisir entre bêche et crayon”, il a répondu les deux, car ils ne sont pas régis par le temps.
En question-clôture, on s’interroge sur son parcours jusqu’à l’artiste que l’on connaît. Sa formation d’ingénieur horticole puis de paysagiste lui aurait apporté un certain rapport au dessin et l’aurait rapproché de l’art du vivant. En 2003, quand son entreprise devient trop lourde à gérer, il se tourne alors vers le statut d’artiste. Avec ce dernier, il ne peut que concevoir ses projets mais pas les faire lui-même, la pratique manuelle est confiée à d’autres personnes chargées de la réalisation de l’œuvre. Il affirme en riant que cela ne lui “manque pas” et qu’il s’y « plaît bien”.